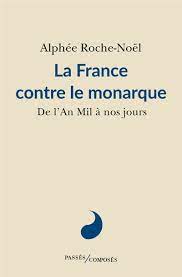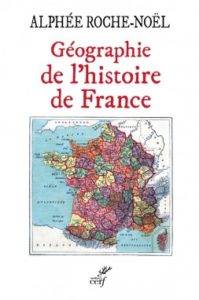Ça commence par une belle couverture presse, bien organisée par la communication gouvernementale. « Place nette XXL ». Attention, Darmanin est là, les « narcos » vont en voir de toutes les couleurs. Macron également a fait le déplacement, entre deux séances de boxe, muscles bandés, sueur au front. Marseille n’est-elle pas « sa » ville, comme les empereurs, les rois avaient les leurs, celles qu’ils honoraient de leurs entrées et de leurs séjours ? On peut supposer que le ministre a moyennement apprécié de voir son n+2 s’inviter sur son terrain de jeu ; qu’importe. En revanche, les très nombreux fonctionnaires de police mobilisés pour l’occasion et pour plusieurs semaines encore auraient quelque raison de s’agacer. Dans cette « guerre » contre la drogue, mise en scène à grand renfort de communication, ne jouent-ils pas le rôle du faire-valoir ? Sans doute jugeraient-ils plus utile qu’on les laisse simplement faire leur métier. Le travail d’enquête est une affaire de patience et de discrétion peu compatible avec les exigences de la téléréalité.
De fait, trois jours plus tard, les résultats paraissent bien maigres, les petites mains arrêtées et déférées, à mille lieues des caïds qui régentent le commerce de la drogue dans la « Cité phocéenne ». Quant aux dealers des plateformes numériques, ils poursuivent leur business en s’excusant, bons commerçants, pour la gêne occasionnée par l’intervention policière (Le Monde du 22/03). Au total, on mesure le décalage entre le spectacle offert au bon peuple et la réalité d’une ville abandonnée à sa propre misère. Il est tellement évident que cette manière de procéder est, non pas insuffisante au regard de, mais intrinsèquement contradictoire aux objectifs que l’État prétend se fixer dans le domaine de la lutte anti-stupéfiants, qu’en faire mention peut paraître superflu. À Marseille, jusqu’à présent, Macron se paie surtout de slogans sans lendemain (« Marseille en grand », dont la Cour des comptes a récemment étrillé l’absence de cadre contractuel, le sous-dimensionnement, l’insuffisance des moyens humains). Naturellement, il n’est pas le seul responsable de l’état présent des choses. Ses devanciers, les ministres, les exécutifs locaux le sont également, qui ont laissé se développer, à l’échelle d’une métropole d’un million d’habitants, une situation incroyablement ségréguée et, du côté nord de la frontière invisible qui coupe en deux l’étroite bande urbaine coincée entre les collines et la mer, indigne d’un pays qui se proclame celui de l’égalité et de la fraternité. Responsables, tous, chacun à la mesure de son pouvoir. Responsables également, à l’échelle nationale, Sarkozy et les siens, qui ont fabriqué il y a vingt ans de cela une police de plus en plus séparée de la population. Au temps du capitalisme sauvage et de la régression sociale, le fossé se creuse entre la police et la société comme il se creuse entre la société des riches et la société des pauvres, il n’y a pas lieu de s’en étonner. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu beaucoup d’impéritie, et également une volonté déterminée de destruction de la puissance publique. Ainsi, à Marseille comme ailleurs, l’« État-providence », ou disons plutôt l’État social, devient peu à peu cet État « gardien de nuit », pudiquement dénommé « État protecteur » par Bruno Le Maire, qu’avait rêvé l’idéologie libérale. Après tout, au Mexique ou à Marseille, les parrains de la drogue ne sont qu’un exemple accompli, soi-disant déviant, du capitalisme le plus orthodoxe. Il n’est pas possible, ou pas honnête, de prétendre les mettre hors d’état de nuire tout en créant méthodiquement les conditions d’un accroissement de leur emprise sur le social.
Ainsi débarrassé du « superflu », l’État pourra se concentrer sur ses fonctions originelles : faire la police et faire la guerre, accessoirement rendre la justice – à supposer que la justice, au sens institutionnel du terme, puisse être rendue de manière satisfaisante lorsque la justice sociale semble devoir être inexorablement broyée par la brutalité des faits sociaux. Signe des temps, les mots de police et de guerre sont furieusement revenus à la mode, en particulier dans le discours des gouvernants – la « guerre » au covid en 2020 puis l’« économie de guerre », avec les piètres résultats que l’on sait (voir le Canard du 20/03). Dans les temps où nous sommes, la guerre, naturellement, n’est pas qu’un leurre, un mythe, un argument rhétorique. Plus exactement, si elle est aussi cela, elle est d’abord une réalité tangible que Poutine, ses oligarques, le système enfin dont il est le symbole et le chef, ont déclenchée contre leurs « frères » d’Ukraine, voici déjà plus de deux ans, sans jamais cesser de menacer l’« Occident global », s’il venait à s’en mêler de trop près, de la guerre mondiale et nucléaire. Face à cette immense folie, il n’y a pas d’autre option que de déployer une immense sagesse. En commençant par rappeler que si, pour les Ukrainiens, et pour les appelés russes, dont beaucoup sans doute s’en seraient passé, la guerre est une réalité vécue, elle n’a pas, elle ne doit pas avoir, ni pour l’Europe, ni pour le monde, le caractère de fatalité qu’on tend de plus en plus à lui donner. Ici et là, en effet, se diffuse cette petite musique que l’affaire est inéluctable, qu’il faut se préparer à la guerre pour défendre « nos valeurs », faute de quoi nous pourrions être les prochains sur la liste. En vérité, cette idée est à peine plus raisonnable que les effrayantes divagations du Kremlin. L’État russe ne vise pas à la domination du monde, ni même de l’Europe, mais de son étranger proche. Nous sommes d’accord que ce n’est pas une raison pour l’y laisser faire n’importe quoi : violer le droit international, bombarder les populations civiles, décider de la couleur des gouvernements des ex-républiques soviétiques. Nous sommes également d’accord qu’un débordement de l’agressivité russe sur un État de l’Otan ou de l’Union nous placerait dans une fâcheuse, et funeste, posture. Mais alors, où sont les armes que l’on promet à Kiev, mois après mois et maintenant année après année, pour fixer le puissant voisin dans le territoire où il importe absolument de circonscrire et d’étouffer le conflit afin d’éviter qu’il n’en déborde les frontières ?
L’Europe doit pouvoir se défendre. Cette idée est d’une telle banalité que jusqu’aujourd’hui elle ne s’est pas souciée de lui donner un commencement de réalité, préférant à l’autonomie stratégique un suivisme atlantiste de mauvais aloi, et hautement inflammable. Elle doit pouvoir se défendre, mais elle doit tout autant être une puissance de paix – elle le doit à son histoire, à son identité même. Il n’y a là rien d’antinomique. Veiller à posséder un instrument militaire en état de marche et préparer la guerre sont deux choses fondamentalement différentes. On peut être un pacifiste convaincu, forcené même, et concevoir que la société doit être prête à toute éventualité, y compris à la plus extrême. Songeons à Jaurès, héraut de l’armée nouvelle, assassiné, à la veille du déclenchement des hostilités, parce qu’il incarnait l’espoir de la paix contre la confrontation soi-disant inéluctable des puissances impérialistes. Alors, quand il semble donner raison aux « experts » du va-t-en-guerrisme avec ses « troupes au sol », quand il persiste et signe en affirmant à propos de l’Ukraine que « la France n’a pas de ligne rouge », Macron s’égare dangereusement. Après avoir songé à Jaurès, on songe inévitablement à Brassens :
Les saint Jean bouche d’or qui prêchent le martyre
Le plus souvent, d’ailleurs, s’attardent ici bas.
Pendant ce temps, l’une des grandes tragédies du début du XXIe siècle se déroule presque sous nos yeux : Gaza, ses plus de 30 000 morts, dont une vaste majorité de civils. Que signifie cette masse, pour nous autres qui n’avons que le mot d’humanisme à la bouche et nous abîmons dans des arguments spécieux pour ne pas reconnaître dans son humanité cette humanité-là ? En cinq mois de temps, seuls quelques organes de notre presse nationale se sont efforcés, et de loin en loin, de mettre des visages sur les chiffres et des noms sur les visages. Cette tragédie cependant est bien la nôtre, non pas parce que nous la vivons dans notre chair, mais parce qu’elle a lieu avec l’accord tacite de gouvernements qui ont beau jeu d’« exiger » le cessez-le-feu quand le plus grand mal a été fait, quand il n’y a déjà plus que des ruines. Pour réagir à l’horreur des massacres du 7 octobre, et à l’ébranlement profond qui en est inévitablement résulté pour la société israélienne, l’État israélien, mû par des chefs pour certains cyniques, pour d’autres, fanatiques, a choisi la violence indiscriminée. Le résultat est épouvantable. Il n’y a guère de mot pour le décrire. D’un État censément « démocratique », cela fait froid dans le dos, mais il est vrai que notre histoire des deux derniers siècles ne nous donne aucun droit à nous sentir irréprochables sur ce terrain. Pour les Palestiniens, c’est une insondable tragédie ; pour Israël, c’est un crime et une erreur grave pour l’avenir. Cela paraît idiot à dire, mais on ne construit pas la paix avec des bombes. Même pas la sécurité. Pour vivre, là-bas comme ici, il faut vivre ensemble, et pour vivre ensemble, il faut se connaître, se reconnaître, discuter, négocier, bâtir des solutions politiques. La force parfois peut être utile. Il arrive qu’elle soit nécessaire, pour autant qu’elle soit maîtrisée, ponctuelle, ciblée, ramenée toujours à sa juste proportion, à sa juste fin. Les démonstrations de force, en revanche, simplement théâtrales ou effectivement meurtrières, ne sont jamais que vaines ou destructrices. Grotesques ou tragiques.